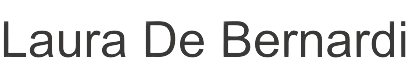Texte critique de Flaminio Gualdoni
Enseignement de l’histoire de l’art ancien à l’Académie des Beaux-Arts de Brera (Milan)
J’ai suivi le parcours de formation de Laura De Bernardi (1970) depuis le milieu des années 1990, quand je l’ai eue comme élève à l’Académie de Brera, à Milan, en la repérant immédiatement comme un cas d’une authentique envergure. Dès lors, il était remarquable que son approche du patrimoine problématique et de l’expérience de l’arte povera qui a caractérisé la majeure partie du débat artistique depuis la fin des années 1960 – elle a longtemps étudié avec Luciano Fabro – ne concernait pas au sens strict les matériaux et leur utilisation, ni le degré de formalisation de la pratique, mais plutôt la question – qui était radicale et décisive – du faire, de l’agir, impliquant dans l’acte l’examen approfondi de la relation ancestrale avec sa propre corporalité, avec la main comme instrument d’intelligence et de connaissance, comme techne originelle, et de l’évolution vers la conscience du « se sentir vivre » et de l’œuvre en devenir (in fieri).
Son approche de la pratique manuelle s’est inscrite dans la perspective paléoanthropologique du propos, avec de fortes implications sociologiques, énoncée par André Leroi-Gourhan dans son ouvrage fondamental Gestes et paroles, Paris 1964 et 1965. De Bernardi, en adoptant une position critique et réfléchie vis-à-vis de la tendance sociale moderne à dévaloriser l’action technique directe des groupes humains au profit de l’adhésion aux apports des innovations technologiques, dans un scénario qui préfigurait déjà la révolution numérique, a considéré le domaine artistique comme celui dans lequel l’individu pouvait le plus se forger une base de valeur et une conscience différentes. Elle a choisi de ne pas élaborer une simple énonciation théorique de sa réflexion sur le sens du toucher, le sens dans lequel se produit et se distille une action esthétique qui peut se révéler comme une valeur en soi, mais de le mettre à l’épreuve in the matter, non seulement comme épicentre de l’action technique corporelle, mais aussi comme mesure intime de la conscience physique et intellectuelle de l’individu.
Certaines expériences des décennies où l’arte povera et, plus encore, l’art conceptuel, ont été accompagnés d’opérations de pratique délibérément « régressive » du « faire », en vue d’une distillation du rapport ancestral de la main avec les choses – Eva Hesse, Joseph Beuys, Claudio Costa -, ont été à l’origine de la recherche tenace, continue, sans déviations uniquement esthétiques, mais toujours fondée sur un état de nécessité interne, de De Bernardi (qui conçoit son travail comme une recherche indépendante des statuts contraignants de la profession d’artiste) et l’ont amenée à symboliser à nouveau des aspects de la création, tels que l’attention portée aux fragments de la réalité naturelle liés à l’acte atavique de la récolte/manipulation, à des procédés tels que la couture qui ne tissent pas tant des formes constituées que la sédimentation d’un temps, d’un rythme, d’une « respiration » des actes : pour reprendre les mots de Pierre Restany, une « réinvention poétique de la réalité ».
Dans le contexte actuel, une intervention de De Bernardi se veut un incident conceptuel radical, dont le rôle pourrait être d’évoquer la substance et la raison du tactile qui sont en jeu, inévitablement et de manière non négligeable, même dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Flaminio Gualdoni
Enseignement de l’histoire de l’art ancien