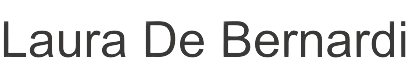Flori-lège
Quand on parle de récolter (« raccogliere », en italien), il faut aussi se référer à cultiver (« coltivare ») et, de là, passer – au nom de l’art (entre autres) – au livre sacré du Qoheleth ou Ecclésiaste, terme qui signifie, selon certaines hypothèses étymologiques, le collectionneur (« raccoglitore»), comme on l’entend d’expérience et de sagesse. Au-delà, tout collecteur/classificateur (« raccoglitore/classificatore ») et rassemblement/réunion (« raduno/adunanza ») sont faits pour se ra-conter peut-être sans s’ac-cueillir.
Qoheleth, le Rassembleur, pseudonyme de l’auteur du texte contenu dans la Bible hébraïque (Tanakh) et chrétienne, nous conduit à son tour à la confluence de art, culture (« coltura », donc culture au sens agronomique du terme) et culture (« cultura », terme se référant à la production et transmission de sens au sein d’une société), dans leur dérivation du colere latin.
L’art est en effet l’un des moyens les plus nobles de se cultiver, non pas pour dire, comme par le passé, que tout est culture, mais pour indiquer une écologie de l’âme qui passe aussi par les formes de la création artistique, c’est-à-dire par une pratique du vivre quotidien jusqu’au travail et au labeur qui se cachent derrière les formes d’art les plus variées et conceptuelles.
Parler de collections d’art (« raccolte » en italien) ne consiste donc pas à exclure la récolte au sens concret et métaphorique. Les formes d’art naturalistes caractérisent cette modernité tardive ou cette post-modernité, avec l’utilisation « florilège » de matériaux ou d’éléments de la nature par l’artiste-artifex qui s’interroge le plus sur lui-même.
L’anthologie, qui est, étymologiquement, une autre forme de collection ou de récolte, née d’un choix (présente dans le mot allemand Ernte), fut appelé, par Pascoli « Fior da fiore ».
« Fleur de farine » et « fleur de peau », sont deux exemples d’une noblesse acquise par une action agricole et, symétriquement, par un sentiment très sensible.
Entre ces deux limites se meuvent, comme guidées par un geste hautement symbolique, celui ample et rond du semeur, les expositions d’art qui veulent être profondément exploratrices et situées dans le temps, comme le dit l’Ecclésiaste, c’est-à-dire au moment opportun (kairos, diraient les Grecs) pour chaque chose. Ceci vaut pour celui qui utilise l’agriculture et l’applique à l’art dans toutes ses valeurs, de celles devenues classiques à celles qui se rapprochent le plus de la performance, action qui fait appel de manière très terre-à-terre à la corporalité et, par conséquent, à notre nature terrestre, et donc pas seulement étymologiquement, à notre condition d’enfants d’Adam.
Paola Colotti
Écrivaine
Musée Vincenzo Vela